RÉSUMÉ
HISTORIQUE L’équipe d’hémostase de Lyon est une structure rassemblant toutes les compétences pour une prise en charge intégrée et innovante des troubles de l’hémostase. Elle se distingue par un trio médico-scientifique solide articulant clinique, biologie et recherche. Elle coordonne le Centre de référence de l’hémophilie
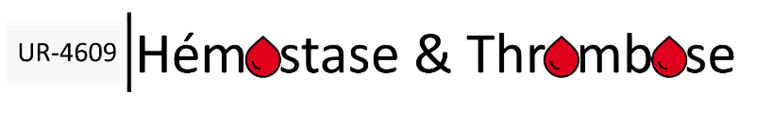
HISTORIQUE
L’équipe d’hémostase de Lyon est une structure rassemblant toutes les compétences pour une prise en charge intégrée et innovante des troubles de l’hémostase. Elle se distingue par un trio médico-scientifique solide articulant clinique, biologie et recherche. Elle coordonne le Centre de référence de l’hémophilie et des déficits rares de coagulation (CRH), avec une expertise reconnue dans les maladies hémorragiques constitutionnelles. Son laboratoire spécialisé en hémostase réunit des compétences spécialisées en analyses phénotypiques et génotypiques. L’équipe est complétée par l’unité de recherche labellisé UR4609 Hémostase et Thrombose, qui travaille sur l’hémophilie.
Historiquement, la structure a été d’abord dirigée par le Pr Marc Dechavanne, avec une orientation marquée vers les pathologies plaquettaires. Un tournant s’est opéré sous l’impulsion du Pr Claude Négrier, dans le contexte de la création des centres de traitement des hémophiles suite au drame du « sang contaminé », positionnant l’hémophilie comme pathologie centrale de l’équipe lyonnaise. Depuis, celle-ci a acquis un leadership national et une visibilité internationale dans ce domaine. Depuis 2021, cette dynamique est portée par un tandem de direction incarnant pleinement cette approche intégrée : la Pr Christine Vinciguerra, cheffe du service d’hématologie biologique, et le Pr Yesim Dargaud, coordinatrice nationale du CRH et directrice de l’UR4609 à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Ce modèle intégré, fondé sur la complémentarité des expertises clinique, biologique et scientifique, permet une prise en charge de pointe et une capacité d’innovation constante au service des patients.
Avant de se recentrer sur l’hémophilie, l’équipe lyonnaise a développé une expertise reconnue dans différentes pathologies hémorragiques constitutionnelles qui constitue encore aujourd’hui un atout majeur pour le diagnostic de nombreux patients à l’échelle nationale. Le Dr Jean-Claude Bordet a ainsi joué un rôle clé dans le développement et l’utilisation de la microscopie électronique pour l’étude de l’ultrastructure plaquettaire, une approche innovante à l’époque, qui reste aujourd’hui un outil diagnostic précieux. Cette activité a été pérennisée par Anaëlle De Wreede, qui assure désormais cette prestation spécialisée pour de nombreux centres en France, en lien étroit avec le Centre de référence des pathologies plaquettaires (CRPP). La synergie entre les biologistes, les cliniciens et leur collaboration étroite avec des chercheurs Inserm ont permis, dès 1990, la création du premier laboratoire de recherche labellisé à Lyon consacré aux pathologies de l’hémostase. Ce laboratoire, à l’interface entre la recherche fondamentale et le diagnostic spécialisé, a joué un rôle précurseur dans la structuration médico-scientifique de la discipline à l’échelle locale. Parallèlement, le Dr Michel Hanss a développé une expertise spécifique dans la caractérisation fine des anomalies du fibrinogène. Son travail a conduit à la création d’une base nationale de données scientifiques, qui reste à ce jour un outil central pour le diagnostic et la compréhension de ces pathologies constitutionnelles du fibrinogène. Cette base fait partie des rares ressources françaises interconnectées avec la base européenne de la société savante EAHAD, renforçant ainsi la contribution lyonnaise à la recherche collaborative internationale.
Le Pr Claude Négrier a non seulement joué un rôle clé dans l’orientation du centre lyonnais vers une expertise affirmée en hémophilie, mais il a également été l’un des médecins pionniers à l’échelle nationale dans la structuration de la prise en charge des maladies rares. Il a activement contribué à la création des Centres de référence maladies rares (CRMR), en s’impliquant dès les premières réflexions institutionnelles sur la reconnaissance et l’organisation des filières de soins dédiées. Grâce à son engagement, les pathologies hémorragiques constitutionnelles, et notamment l’hémophilie, ont été intégrées dès la première vague de plan national maladies rares (PNMR) en 2014. Cette reconnaissance précoce a permis de structurer une filière nationale, avec un centre coordonnateur à Lyon, assurant une organisation cohérente des soins, du diagnostic, du suivi des patients et de la recherche. L’action du Pr Négrier a ainsi joué un rôle moteur dans la visibilité et la reconnaissance de ces pathologies à l’échelle nationale et internationale. Durant la période où le Pr Claude Négrier a dirigé le centre de Lyon, les activités de recherche de l’équipe se sont structurées autour de deux axes scientifiques majeurs, étroitement liés aux enjeux thérapeutiques de l’époque. Le premier portait sur la caractérisation moléculaire et le génotypage de l’hémophilie sous la responsabilité du Pr Christine Vinciguerra, contribuant à une meilleure compréhension des corrélations génotype-phénotype, ainsi qu’à l’amélioration du conseil génétique et du diagnostic prénatal. Le second axe de recherche était centré sur le développement et l’évaluation de nouvelles molécules recombinantes de facteurs VIII et IX, avec pour objectif d’optimiser la demi-vie, l’efficacité et le profil de sécurité des traitements substitutifs, afin de mieux répondre aux besoins thérapeutiques non couverts des patients atteints d’hémophilie. Cette dynamique, à l’interface entre recherche translationnelle et innovation thérapeutique, a été portée par les Dr Jean-Luc Plantier, Dr Nathalie Enjolras et Pr Yesim Dargaud. Leurs travaux ont permis de positionner le centre de Lyon comme acteur clé dans la
recherche préclinique sur l’hémophilie en France.
MISSIONS ET OBJECTIFS
En tant que centre coordonnateur du Centre de référence pour l’hémophilie, nos actions cliniques sont orientées prioritairement vers l’amélioration du parcours de soins des patients atteints d’hémophilie et de déficits rares de la coagulation. Notre objectif est d’assurer une homogénéisation de la prise en charge sur l’ensemble du territoire français, afin de garantir une équité réelle dans l’accès aux soins, y compris dans les territoires d’Outre-Mer.
Nous nous positionnons comme un acteur engagé dans le développement et la mise en œuvre de thérapeutiques innovantes. À ce titre, nous contribuons activement à la personnalisation des traitements, en intégrant les avancées scientifiques et technologiques les plus récentes, dans le but de répondre de manière ciblée aux besoins spécifiques de chaque patient. Nous soutenons la multidisciplinarité et un parcours de soins coordonné pluridisciplinaire pour les patients hémophiles. À travers nos hôpitaux de jour, qui rassemblent des expertises complémentaires pour offrir un suivi optimal, chaque patient bénéficie d’un bilan approfondi annuel et d’un traitement personnalisé adapté à ses besoins individuels. La participation au sein de l’équipe du Dr Valérie Chamouard, pharmacien spécialisé en hémostase, a favorisé le développement de pratiques innovantes telles que des consultations pharmaceutiques sur les médicaments anti-hémophiliques et les anticoagulants, ainsi que la mise en place de projets de recherche et de formations dédiés aussi bien aux patients qu’aux pharmaciens d’officine. Son expertise permet également de faciliter les interactions avec les tutelles, notamment dans le cadre des demandes d’accès dérogatoires aux traitements. En plus des professionnels traditionnels tels que médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, kinésithérapeutes et biologistes, nous intégrons de nouvelles professions comme les enseignants en activité physique adaptée et les psychomotriciens. Leur contribution enrichit notre approche dans la lutte contre l’arthropathie et renforce notre engagement envers le bien-être complet de nos patients. Le centre a un programme d’éducation thérapeutique qui attire de nombreux patients tous les ans et qui a permis l’autonomisation des patients dans leur prise en charge thérapeutique et la préparation du terrain pour la pratique de prise de décision partagée avec des patients ayant une bonne connaissance et compréhension de leur pathologie.
Le développement de la recherche et de la formation en hémophilie constitue un axe stratégique de nos missions. Le laboratoire d’hémostase spécialisé joue un rôle clé en développant des méthodes de suivi innovantes pour les traitements de l’hémophilie, ainsi que des techniques avancées de biologie moléculaire visant à améliorer la caractérisation génotypique des patients. De nouvelles approches biologiques contribuent à lutter efficacement contre les situations d’impasse et d’errance diagnostique, encore trop fréquentes.
Par ailleurs, notre unité de recherche spécialisée a concentré ses travaux, au cours des quatre dernières années, sur deux thématiques majeures répondant à des besoins non couverts et à des défis persistants en hémophilie : l’arthropathie hémophilique, complication majeure invalidante, pour laquelle nous explorons de nouvelles approches de prévention et de prise en charge et le rôle du facteur IX extravasculaire dans l’hémophilie B, un domaine émergent porteur de perspectives thérapeutiques. À travers l’ensemble de ces actions, notre centre coordonnateur du CRH poursuit sa mission : structurer, innover et diffuser une prise en charge optimale de l’hémophilie et des déficits rares de la coagulation sur tout le territoire national.
RESSOURCES, ORGANISATION et COMMUNICATION
L’équipe lyonnaise, structurée autour de ces trois entités complémentaires, rassemble aujourd’hui 15 professionnels médicaux et 14 personnels paramédicaux, aux compétences pluridisciplinaires et complémentaires.
L’unité d’hémostase clinique comprend quatre médecins, dont un pédiatre, une pharmacienne, trois infirmières, une psychologue, une enseignante en activité physique adaptée (APA), une psychomotricienne, une chargée d’études et deux attachés de recherche clinique (ARCs). Cette équipe pluridisciplinaire assure une prise en charge globale et personnalisée d’une file active importante de patients, qui constitue l’une des plus importantes cohortes de patients hémophiles en France. La mise en place d’un hôpital de jour, fondé sur une approche pluridisciplinaire et une prise en charge coordonnée en un lieu unique sur un temps restreint, a permis de renforcer significativement le suivi des patients.
Au cours des 15 dernières années, les traitements de l’hémophilie ont connu une évolution majeure : développement de facteurs à demi-vie prolongée, introduction de mimétiques du facteur VIII, apparition de molécules modulant l’équilibre de l’hémostase et avancées significatives dans la thérapie génique. Ces innovations ont profondément transformé la prise en charge des patients, imposant de nouveaux paradigmes cliniques et la nécessité d’une prise de décision partagée entre patients et professionnels de santé – une approche désormais centrale pour une médecine plus personnalisée, adaptée aux préférences et aux besoins de chacun. Certaines de ces innovations thérapeutiques, telles que la thérapie génique, ont nécessité la mise en place d’un nouveau parcours de soins à l’échelle nationale, spécifiquement adapté aux enjeux de ces traitements de rupture. Ce parcours, piloté par le CRH de la filière MHEMO, a bénéficié de la participation active des membres de l’équipe lyonnaise engagés tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre opérationnelle. L’ensemble de ces activités cliniques sont régulièrement communiquées sur le site du CRH (www.crh-hemophilie.fr) ainsi que sur le réseau social LinkedIn.
Le laboratoire d’hémostase spécialisée réunit huit biologistes, dont trois experts en biologie moléculaire. Il couvre l’ensemble des explorations diagnostiques et du suivi des troubles de l’hémostase, en investiguant l’hémostase primaire, la coagulation et la fibrinolyse. Le laboratoire est reconnu au niveau international pour son expertise dans les tests globaux d’hémostase et plus particulièrement le test de génération de thrombine, dont il a largement contribué à développer les applications cliniques chez les patients hémophiles.
L’équipe intègre également une activité de recherche dynamique, portée par deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) et un maître de conférences-praticien hospitalier (MCU-PH), qui encadrent régulièrement deux à trois doctorants au sein de l’unité de recherche, avec le soutien d’un post-doctorant.
Cette synergie entre soins, recherche et innovation renforce la qualité et la pertinence du suivi proposé aux patients.
ACTIONS DE RECHERCHE ET COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES
Recherche préclinique et translationnelle
Le centre se distingue par une activité de recherche particulièrement dynamique, organisée autour de 4 axes.
Description et caractérisation des anomalies moléculaires responsables d’hémophilie
L’unité joue un rôle de leader national dans le génotypage de l’hémophilie, tant sur le plan de la recherche que du diagnostic. Cette expertise s’inscrit dans les activités de caractérisation et de prise en charge des maladies rares hémorragiques, sous la coordination du centre de référence de l’hémophilie au sein de la filière MHEMO.
Les hémophilies sont des pathologies hémorragiques héréditaires à transmission récessive liée à l’X. Nos travaux récents sur la génétique des hémophilies ont porté principalement sur deux thématiques :
1. Caractérisation de variants introniques profonds dans les gènes F8 et F9 chez des patients en échec de diagnostic moléculaire
Le diagnostic moléculaire conventionnel des hémophilies consiste en l’étude des régions codantes des gènes F8 et F9, la recherche d’anomalies du nombre de copies par MLPA et la recherche des grandes inversions récurrentes du gène F8. Cependant, 5 à 10 % des formes non sévères d’hémophilies restent génétiquement non résolues. Ces pathologies étant des maladies monogéniques dont le diagnostic de certitude est biologique, nous avons émis l’hypothèse de l’existence de variants pathogènes dans les régions introniques non étudiées des gènes F8 et F9. Et nous avons ainsi décrit 30 variants introniques profonds pathogènes dans les gènes F8 et F9. Ces variants peuvent être classés en deux catégories :
• les variants créant des sites d’épissage de novo : ces variants sont localisés de manière aléatoire dans les gènes et sont bien détectés par les logiciels de prédiction (SpliceAI) ;
• les variants modifiant des séquences régulatrices de l’épissage : ces variants sont concentrés dans des régions particulières des gènes et vont avoir le même effet sur l’épissage (activation du même pseudo-exon). Ces variants sont très mal détectés par les logiciels de prédiction in silico.
Ces travaux sont actuellement poursuivis avec l’objectif de décrire de nouveaux mécanismes moléculaires pour des variants introniques profonds candidats dont les analyses minigènes se sont avérées négatives.
2. Caractérisation de réarrangements génomiques de grande taille dans la région Xq28 impliquant le gène F8.
Le gène F8 est localisé à l’extrémité du bras long du chromosome X (Xq28). Cette région est connue pour être sujette aux réarrangements génomiques de grande taille. Nous avons cherché à décrire les mécanismes moléculaires responsables de ces réarrangements parfois complexes notamment en identifiant par différentes stratégies les points de cassure (séquençage de gène entier ou séquençage de génome). Nous avons ainsi pu montrer que les cas d’hémophilie A sévère en échec de diagnostic moléculaire étaient tous causés par des réarrangements génomiques interrompant le gène F8 (grandes inversions ou grandes insertions). De plus, la richesse en région répétée (notamment en séquence Alu) du gène F8 était probablement un facteur favorisant les réarrangements génomiques.
Cette thématique est actuellement poursuivie avec le projet d’utilisation des technologies de séquençage long-fragment (nanopore) pour la caractérisation de réarrangement génomique de la région Xq28 impliquant des duplications segmentaires de grande taille (int1h et int22h) dont l’étude est actuellement impossible avec les technologies conventionnelles dites « Short-read ».
Le développement de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques pour l’arthropathie hémophilique
Malgré les avancées spectaculaires des traitements de l’hémophilie au cours des 20 dernières années, l’arthropathie hémophilique (AH) demeure une complication grave de la maladie. Ce constat nous a conduits à recentrer nos recherches sur ce sujet, encore peu investi par les équipes françaises et insuffisamment exploré à l’échelle internationale.
Dans cette perspective, nous avons récemment établi une collaboration de recherche avec l’équipe du Pr Leonard Valentino (Université de Rush, Chicago, États-Unis, et président de la Fédération mondiale de l’hémophilie – États-Unis), dont les travaux publiés entre 2010 et 2015 ont largement contribué à la compréhension des mécanismes physiopathologiques de l’AH.
L’AH est la principale complication de l’hémophilie, responsable d’un handicap physique et social majeur. Elle résulte de saignements articulaires répétés, entraînant une atteinte dégénérative progressive de l’articulation. Cette dégradation débute par une synovite chronique, évolue vers une destruction cartilagineuse et aboutit à une détérioration osseuse irréversible. Bien que les progrès thérapeutiques aient considérablement amélioré la prise en charge prophylactique et réduit la fréquence des hémarthroses symptomatiques, les lésions articulaires persistent comme une complication majeure de la maladie. Nos travaux de recherche visent à répondre à deux besoins cliniques majeurs non comblés :
• le diagnostic précoce de l’AH, permettant une intervention plus précoce et une optimisation de la prophylaxie ;
• le développement de traitements ciblés, notamment pour les stades précoces et réversibles de l’atteinte articulaire.
Un diagnostic précoce de l’AH permettrait d’intensifier la prophylaxie et d’optimiser la protection articulaire, soulignant ainsi la nécessité de nouveaux outils de détection. En pratique clinique, les scores articulaires cliniques sont couramment utilisés lors des consultations de suivi, mais leur sensibilité pour détecter les atteintes précoces est limitée. L’IRM est considérée comme l’examen de référence, mais son coût élevé, son accessibilité restreinte et la durée d’examen nécessaire pour explorer les six articulations principales (chevilles, genoux, coudes) en limitent l’usage. L’échographie articulaire, bien que de plus en plus utilisée, souffre d’une importante variabilité inter-opérateurs. La recherche de biomarqueurs fiables, accessibles et peu invasifs représente donc un enjeu crucial pour le dépistage précoce de l’AH.
Notre équipe et d’autres groupes de recherche ont exploré plusieurs biomarqueurs protéiques impliqués dans le métabolisme du cartilage et de l’os, ainsi que dans l’inflammation et l’angiogenèse. Nos travaux récents ont exploré les microARN (miARN) circulants comme biomarqueurs d’arthropathie hémophilique. Ces petits ARN régulateurs jouent un rôle clé dans la régulation post-transcriptionnelle de plus de 60 % des gènes humains. Déjà utilisés comme biomarqueurs diagnostiques et pronostiques dans de nombreuses pathologies, ils n’avaient jusqu’à présent jamais été étudiés dans l’AH. Contrairement aux autres types d’ARN, les miARN circulants sont particulièrement stables, protégés contre la dégradation enzymatique par leur encapsulation dans des exosomes ou leur liaison aux lipoprotéines. Leur robustesse permet une analyse fiable, même après plusieurs cycles de congélation-décongélation. Nous avons récemment mené une étude de preuve de concept pour identifier des miARN spécifiques de l’AH. Cette étude a permis d’identifier et de valider deux miARN associés aux formes avancées de la maladie. Ces deux miARN jouent un rôle clé dans les processus de minéralisation et de remodelage osseux, contribuant ainsi aux altérations observées dans l’AH avancée.
Le second axe de nos recherches sur l’AH porte sur le traitement spécifique des lésions articulaires précoces, en particulier la synovite, seul stade réversible de l’atteinte articulaire. Agir à ce stade pourrait permettre de bloquer le processus dégénératif et préserver la fonction articulaire. Nous explorons également des stratégies visant à traiter précocement les atteintes cartilagineuses naissantes afin de limiter leur progression.
Nous étudions actuellement la modification de l’expression des miARN dans un modèle murin d’hémophilie A après des hémarthroses répétées. Ce travail pourrait permettre d’évaluer leur pertinence en tant que biomarqueurs précoces et d’améliorer la compréhension des mécanismes moléculaires impliqués dans l’AH, voire développer des thérapeutiques innovantes potentielles de type miRNA anti-sens.
Nous travaillons également sur le traitement préventif et curatif de la synovite dans un modèle murin d’AH. Ce projet vise à identifier des approches thérapeutiques innovantes capables de moduler l’inflammation synoviale et de prévenir la dégradation articulaire.
L’amélioration des connaissances sur le rôle du facteur IX dans l’hémostase et le développement de nouvelles molécules de facteur IX recombinantes améliorées
Nous avons développé une nouvelle molécule recombinante de facteur IX humain (rFIX) à demi-vie prolongée en utilisant la technologie de fusion avec la sous-unité B du facteur XIII (FXIIIB) comme protéine porteuse, qui a fait l’objet d’un brevet international (WO 2019/020966 A1). Les mécanismes sous-jacents à cette prolongation de demi-vie ont été explorés en collaboration avec deux équipes de recherche académiques : le laboratoire du Pr Alisa Wolberg (Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, Etats-Unis), et l’équipe de biochimie de l’hémostase à l’Université de Bonn en Allemagne dirigée par les Professeurs Oldenburg et Biswas.
Nos travaux actuels se concentrent sur les propriétés extravasculaires de notre protéine de fusion rFIX-FXIIIB ainsi que sur celles du variant FIX Padua (R338L), qui présente une activité spécifique 7 à 8 fois supérieure à celle du FIX sauvage, et est largement utilisé dans le cadre de la thérapie génique de l’hémophilie B. Nous explorons également le rôle potentiel de systèmes cellulaires comme réservoirs extravasculaires (extra-plasmatiques) de FIX, notamment les synoviocytes, les cellules endothéliales et les plaquettes.
L’optimisation des tests de laboratoire pour une prise en charge thérapeutique personnalisée des patients hémophiles, avec un objectif de standardisation et d’application clinique
L’émergence de nouvelles stratégies thérapeutiques dans l’hémophilie, ne reposant pas sur le remplacement du facteur déficient, nécessite une refonte des approches de surveillance biologique, les dosages conventionnels du facteur VIII (FVIII) et du facteur IX (FIX) n’étant plus adaptés. Ces thérapies non substitutives, bien que diverses dans leurs mécanismes d’action, partagent une caractéristique commune : l’augmentation de la génération de thrombine.
Toutefois, cet effet s’accompagne d’un risque potentiel de thrombose, en cas de production excessive de thrombine. Ce phénomène est l’inverse du traitement anticoagulant, qui réduit la génération de thrombine et expose au risque hémorragique. La capacité de production de thrombine étant diminuée dans les troubles hémorragiques congénitaux et augmentée dans les états prothrombotiques, elle constitue un déterminant majeur de l’équilibre hémostatique.
Dans ce contexte, le test de génération de thrombine (TGA) apparaît comme un outil clé pour la personnalisation des thérapies non substitutives, offrant une évaluation dynamique et globale de l’hémostase. Il permet notamment :
• d’adapter les traitements individualisés en fonction du profil hémostatique des patients ;
• d’évaluer l’efficacité et la sécurité des stratégies thérapeutiques combinées, incluant les thérapies non substitutives associées aux agents by-passants ou aux concentrés de FVIII/FIX ;
• de détecter/prédire un état d’hypercoagulabilité, réduisant ainsi le risque de complications thrombotiques.
Au cours des cinq dernières années, nous avons adapté et optimisé le TGA pour son application aux nouvelles thérapies innovantes de l’hémophilie.
Recherche clinique
Durant les 5 dernières années, notre centre a mené 34 projets de recherche clinique sur l’hémophilie, dont 10 études académiques et 24 études industrielles. La majorité de ces travaux portent sur des approches thérapeutiques innovantes visant à révolutionner la prise en charge de l’hémophilie A et B, en s’affranchissant de la substitution traditionnelle par les facteurs VIII ou IX. Ces études ont joué un rôle déterminant dans le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques, contribuant à l’émergence de traitements plus efficaces, personnalisés et mieux adaptés aux besoins des patients.
Parmi ces avancées, on trouve des anticorps monoclonaux bispécifiques imitant l’activité hémostatique du FVIII activé, la réduction de la synthèse d’antithrombine par l’utilisation de siARN, ainsi que des inhibiteurs ciblant le TFPI ou la protéine C activée. Un facteur VIII recombinant hautement amélioré, doté d’une demi-vie ultra-longue, a également été développé. Ces nouvelles thérapies ont le potentiel de transformer profondément les stratégies de traitement des patients hémophiles, modifiant ainsi les approches traditionnelles.
Certaines de ces molécules (siARN anti-antithrombine, serpine PC et Mim8) ont été évaluées au stade préclinique dans notre laboratoire UR4609, avant de faire l’objet de rigoureux essais cliniques au sein de notre centre. Lyon bénéficie ainsi d’une activité de recherche clinique et pré-clinique particulièrement dynamique dans le domaine des thérapeutiques de l’hémophilie, avec de nombreuses études académiques et industrielles réalisées au cours des cinq dernières années. Actuellement, plusieurs essais cliniques sont en cours dans notre centre, y compris des essais de thérapie génique et bientôt d’édition génomique.
ACTIONS DE FORMATION
L’hémostase clinique est une surdiscipline d’hématologie qui rencontre une pénurie de praticiens en France et en Europe. Consciente de l’enjeu majeur de la formation des médecins pour cette activité clinique, qui recrute des praticiens issus de spécialités différentes comme la biologie médicale, l’hématologie, la pédiatrie, la rhumatologie, la médecine interne, ou la médecine générale, l’équipe de Lyon a créé en 2006 et en 2010 deux diplômes universitaires d’hémostase clinique et d’hémostase biologique respectivement. Récemment, ces enseignements ont laissé place à un Diplôme Inter Universitaire National d’Hémostase et Thrombose auquel participent activement les membres de l’équipe lyonnaise. En parallèle, un DIU européen d’Hémostase Clinique créé en 2022 est piloté par l’équipe lyonnaise et il vient d’élargir son périmètre avec un enseignement en anglais et des partenariats universitaires en France, en Italie, en Suisse, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. L’équipe assure également la coordination du groupe de travail e-learning de la société savante européenne EAHAD et organise des webinaires et podcasts mensuels sur diverses thématiques concernant les pathologies hémorragiques.
Certains membres de l’équipe sont impliqués dans le pilotage des sociétés savantes nationales (C. Vinciguerra et S. Meunier font partie du bureau de la SFTH, C. Nougier fait partie du groupe BIMHO) et internationales (Yesim Dargaud est co-chair du sous-comité FVIII-FIX de l’ISTH et membre du steering committee du registre européen EUHASS de l’EAHAD, elle est également membre du groupe de travail EAHAD sur les déficits rares de coagulation).
PERSPECTIVES
L’équipe s’enrichit constamment de l’arrivée de jeunes talents qui prennent le flambeau des actions cliniques
(Dr S. Désage), biologiques (Dr Y. Jourdy, Dr E. Jousselme, Dr A. Dericquebourg et Dr H. Rezigue) et de recherche fondamentale (Dr A. Leuci). Cette capacité de renouvellement permanent est la garantie de la poursuite et de l’amélioration future des activités menées par l’équipe actuelle. Nous avons récemment développé un nouveau partenariat de recherche avec l’équipe du Pr Philippe Connes, spécialisée dans les pathologies des globules rouges et plus particulièrement sur la drépanocytose, ce qui nous a permis d’ouvrir un nouvel axe de recherche sur les interactions hémostase et globules rouges et de remporter en 2024 un appel à projet européen Marie Curie qui témoigne de la solidité de cette jeune coopération.


